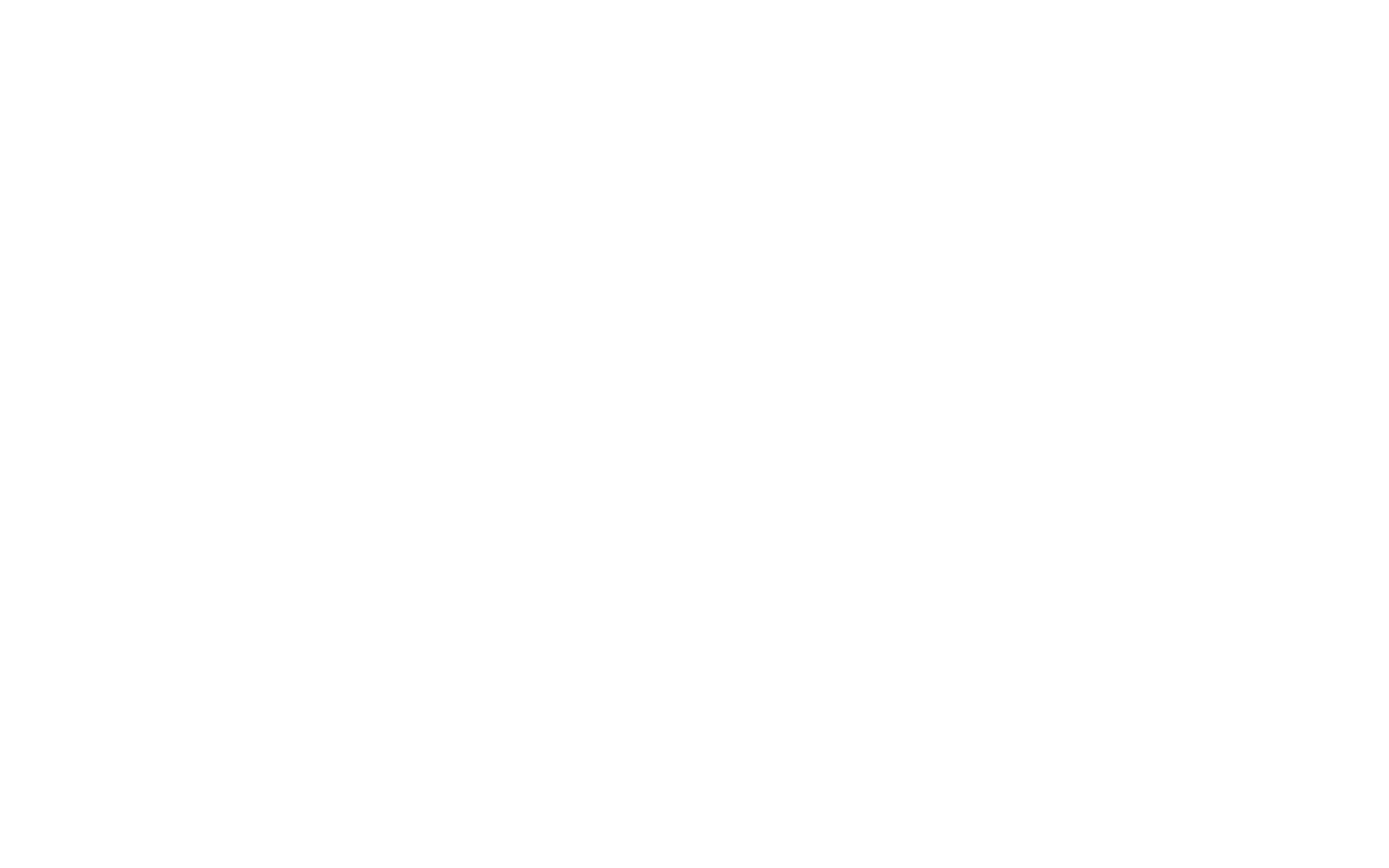
Depuis six ans, Maxime Kurvers développe un travail artistique qui rencontre la réflexion théorique de sa discipline. De formation scénographique, l’artiste propose ainsi des formes qui n’ont rien d’ordinaire et qui remettent la question de l’acteur au centre du plateau. Nous nous sommes rencontrés au Théâtre Garonne où il présentait deux propositions dans le cadre de La Biennale de Toulouse en début de saison. Ensemble, nous sommes revenus sur son approche du plateau, sa vision du théâtre, et la manière dont elles trouvent leur écho dans sa dernière pièce Okina, en tournée après sa création en octobre pour le Festival d’Automne à l’Atelier de Paris CDCN.
En quoi consiste ton travail artistique ?
Sans parler forcément du travail en général, mais peut-être de la séquence dans laquelle je suis et qui a commencé en 2018 : j’ai décidé de recentrer mon travail sur la question de l’acteur. Ce n’était pas forcément une évidence au tout début. Je faisais des pièces sans scénographie, mais avec des opérations très conceptuelles sur le dispositif théâtral. C’est à partir de la troisième pièce, qui s’appelle La naissance de la tragédie, que j’ai eu cette idée de m’intéresser aux coordonnées théâtrales, à la question du répertoire, de ce que les acteurs ont à raconter, donc de faire parler des acteurs. Depuis, j’ai découvert un truc dans ma manière de penser ma tâche, ma fonction, ma responsabilité en tant que « metteur en scène » (avec 45 guillemets). Je ne voulais plus avoir de coup d’avance sur l’expertise des acteurs. Ce que j’essaie de faire, c’est d’imaginer des pièces qui invitent des acteurs à travailler sur un sujet qui les concerne plus ou moins directement, et la pièce rend compte de ça. Après, il y a eu un travail au long cours qui s’appelle Théories et pratiques du jeu d’acteur·rice (1428-2021) – Une bibliothèque vivante pour l’art de l’acteur·rice. C’est le titre (rire). C’est une fresque de 10 heures, dont chacun des 28 chapitres mène à la rencontre de cet acteur qu’on voit sur scène. C’est généralement un petit solo, mais ça peut être d’autres formats, avec un fragment d’une pensée théorique ou une prescription méthodologique issue de l’histoire du théâtre. Mon postulat était qu’au final, il y a une littérature théorique qui existe, mais que les premiers concernés n’en ont pas vraiment l’usage, puisque la pratique du jeu ou de la mise en scène est excessivement contextuelle. On règle des situations données par la pièce, on n’a pas le temps d’aller relire tout ça. Or, il y a là-dedans des fondements pour le jeu et surtout une croyance dans l’idée que l’acteur est un être plastique.
Ce qui soulève la question de comment on fait théâtre de ces textes-là...
Absolument, c’était tout l’enjeu. Mais chaque acteur avait sa propre méthode. C’est pour ça que j’avais fait une distribution avec sept personnes qui étaient d’héritages théâtraux, d’âges, de cultures très différents... et pour qui le signifiant même de théâtre ou de technique théâtrale n’était pas du tout au même endroit. Donc mon enjeu, c’était de rendre compte de comment chaque personne se dépêtrait avec ça. Ça dépendait aussi de la mesure des textes qu’ils abordaient, il y en a qui sont très méthodologiques. Il suffit presque d’ouvrir le livre, de faire littéralement ce qui est écrit et déjà, on a du théâtre. Mais il y a des textes qui sont beaucoup plus dans une espèce de poétique vaporeuse, avec un degré d’idéalité tel qu’il y a un mystère, on ne sait pas trop... Tout le travail était de juger l’écart entre cette idéalité et ce qu’on peut en faire. La mise en scène, ce qu’elle venait appuyer, c’est cet écart. Qu’on le veuille ou pas, il y aura toujours un écart, sauf peut-être dans le cas de Yoshi Oida...
On se retrouve précisément alors que tu présentes 4 questions à Yoshi Oida au Théâtre Garonne. Qu’en est-il de cette rencontre ?
Yoshi, je l’ai rencontré dans le cadre de cette recherche qui a donné lieu à ce projet de 10 heures. Dans ce projet, il avait quatre chapitres que j’ai récupérés pour en faire ce spectacle autonome, 4 questions à Yoshi Oida. Je lui ai proposé qu’on se rencontre parce qu’il avait cette particularité d’être à la fois acteur et théoricien, en tout cas d’avoir documenté, écrit, réfléchi sur sa propre pratique. Il avait cette double position, ça restait quand même assez singulier. Ce que j’ai identifié chez lui, c’est qu’il a cette manière de répondre à mes questions, qui ne concerne pas uniquement le théâtre. Il trouve toujours une réponse en extrapolant une pensée plus globalisante de ce que c’est qu’être un petit bonhomme de 90 ans sur Terre. Avec son âge, il y avait aussi le témoignage d’une certaine séquence théâtrale à laquelle je suis... non pas étranger, mais où est-ce que je me situe vis-à-vis de l’historicité de ma propre discipline ? Le sentiment d’arriver dans une fin de séquence de ce qu’on appelait théâtre post-dramatique, d’avoir vraiment pu, en tant que spectateur, jouir de ce type de théâtralité-là... C’est ça qui a fondé mon rapport au théâtre.
On arrive peut-être à un changement de paradigme sans trop comprendre ce qui se passe. Du fait de me sentir un peu perdu, je me suis dit : « Je vais aller revoir ce qui fonde la littérature et la discipline théâtrales pour essayer de comprendre ». Spoiler, je n’ai pas trouvé de solution, mais ça m’a donné l’idée de faire plusieurs spectacles.
Toutes ces approches peuvent paraître très hermétiques, comment l’appréhendes-tu ?
Je ne les ai jamais considérées comme hermétiques, je n’ai pas ce rapport-là aux choses. Je suis même un peu dilettante dans mon approche de ces sujets. Par exemple, pour le spectacle avec Yoshi, il a bien voulu le faire à condition que ça reste un dialogue. Ça aurait pu être un solo où il était sur scène, mais il a refusé de débiter ce qu’il a déjà écrit dans trois livres. Il m’a dit « Mais discuter avec toi, je veux bien, ça m’intéresse ». Et c’est un avantage, d’une certaine manière je sers aussi de figure d’identification pour les gens, je suis un peu l’ingénu à côté qui écoute. De la même manière, pour Okina qu’on va faire en janvier, l’actrice qui va traiter de cette pièce rituelle va désamorcer tout de suite la chose en racontant assez vite qu’elle ne connaissait rien avant qu’on travaille dessus ensemble. Le principe, c’est qu’on avance ensemble.
En début d’entretien, tu te décrivais comme « metteur en scène » avec des guillemets... Pourquoi ?
Je trouve que c’est trop facilement une position violente si elle est dans l’attente d’assouvir des visions, un fantasme... Donc j’essaie de voir s’il existe une autre position. Je pense que ça vient de la deuxième pièce que j’ai faite, très conceptuelle, où j’avais dit aux acteurs ce qu’ils devaient faire. Finalement, j’avais l’impression de voir mon cerveau exposé sur scène, c’était horrible. C’est pour ça que j’ai décidé de reverser absolument tout sur l’expertise des gens qui sont sur ce plateau. Je veux bien lâcher ce que je peux imaginer être mes idées les plus brillantes, si l’acteur au plateau apporte une dimension organique plus riche qui vient métaboliser l’idée que j’avais au départ. Le rêve, c’est quand même que le spectacle produise une expérience tout à fait différente de ce qu’on avait prévu à l’origine.
Il y a un terme qui te conviendrait mieux que « metteur en scène » ?
Non, on met « conception, mise en scène » dans les programmes, mais c’est pour dire quelque chose. Mon rôle, c’est de rappeler aux interprètes qu’ils doivent trouver comment se positionner par rapport au spectacle. Et ça, je pense que ça vient de la scénographie, c’est-à-dire de penser le dispositif théâtral comme une espèce d’agencement social inédit, inégalé, inégalable. Ça peut prendre toutes les formes possibles, il suffit juste de savoir comment, par ta parole ou par tes actions, ça peut regarder les autres autant que ça te regarde.
On a évoqué quelques-uns de tes précédents projets, que peux-tu dire sur ta dernière création, Okina ?
Dans le théâtre nō, les actrices ont le droit de tout faire comme les hommes, sauf une pièce, Okina, pour des raisons rituelles liées au fait que les femmes ont leurs règles. On pense qu’elles sont touchées par un concept qui s’appelle « Kegare », qu’on pourrait traduire par l’idée de souillure. Or la pièce est une théophanie, autrement dit l’apparition d’un dieu via la transfiguration humaine. Et comme les femmes sont soi-disant touchées par cette notion de « Kegare », on considère que le fait de s’approcher de cette pièce viendrait détruire la théophanie. En apprenant ça, je suis un peu fasciné. Dans notre théâtre contemporain, tout le monde peut tout jouer. Il y a évidemment plein d’interdits non nommés, mais c’est rare d’être confronté à un interdit de représentation aussi frontal. Puis j’ai rencontré Yuri Itabashi à Paris, je lui ai parlé du projet et elle a halluciné quand je lui ai dit qu’il y avait une pièce interdite aux femmes. C’est une actrice de théâtre expérimental japonais, donc cette notion d’interdit, de prescription, elle en est loin. D’une certaine manière, ça ne la concerne pas directement. Cependant, il reste quand même une tension à savoir comment on se positionne par rapport à cet interdit. La pièce essaie finalement de rendre compte de l’enquête de Yuri vis-à-vis de cette histoire, cette tradition. Dans La naissance de la tragédie, l’acteur racontait comment il imaginait que cette première tragédie avait eu lieu, mais il n’en montrait rien. Je me suis dit qu’on pouvait appliquer le même protocole pour Okina.
Entretien de Maxime Kurvers avec Peter Avondo, Snobinart, numéro de janvier 2025
MAXIME KURVERS : « LE THÉÂTRE EST DEVENU UN FÉTICHE POUR UNE ÉLITE CULTURELLE DÉCULTURÉE »
Décortiquer le théâtre par le théâtre. Comprendre sa source, actualiser sa fonction politique, et ce avec les outils les plus humbles – une scène, des comédiens. Le metteur en scène Maxime Kurvers s’y attelle depuis une dizaine d’année dans des pièces ascétiques en apparence, mais généreuses dans leurs intentions. Dans La naissance de la tragédie en 2018, un comédien, seul, donnait à vivre la première représentation de l’histoire. Dans Théories et pratiques du jeu d'acteur·rice (1428-2021) en 2020, un casting complet déroulait des siècles de méthodes d’acting et les séquences socio-politiques qui les ont produites. Aujourd’hui, le metteur en scène enjoint la comédienne Yuri Itabashi à accomplir l’impossible : interpréter, en tant que femme, Okina, seul rituel du répertoire nippon à être défendu aux comédiennes. En plateau : le minimum. Conceptuellement : c’est chargé.
Vous vous dites incapable de traiter de sujets extérieurs au théâtre. Pour autant, en décortiquant le médium théâtral – son histoire, son rôle social –, votre travail ne se connecte-t-il pas avec tout ce qui fait société ?
Je me sens incapable de produire un théâtre « à thèmes ». Et je me méfie de la façon dont la matrice culturelle nous enjoint à produire des objets thématiques directement identifiables. Il n’importe plus vraiment que ces « thèmes » soient ou non métabolisés par la scène : le storytelling qui précède certains spectacles est tel qu’il nous décharge quasiment d’aller les voir. Or, si je travaille le théâtre par le théâtre, c’est qu’à mes yeux le « sujet-théâtre » – par son dispositif, son organisation, sa division du travail, sa générosité, ses violences –, est déjà signifiant. Et que le théâtre n’est peut-être jamais plus légitime pour parler du monde que lorsqu’il s’intéresse à sa propre organisation.
Cette obsession pour le dispositif théâtral découle également de mon refus d’exercer le métier de scénographe pour lequel j’ai été formé. Quand j’étais étudiant, la scénographie, c’était le rêve : littéralement celui de la fabrication des spectacles. Mais j’ai été rapidement désillusionné par le gaspillage matériel lié à la création de décors. Je me souviens par exemple avoir vu des ouvriers qualifiés se bousiller les bronches à laquer des surfaces immenses de parquet de scène, qui se retrouveraient découpées en cales-portes quelques mois plus tard. Ce genre de visions absurdes m’a poussé à abandonner l’idée de produire des objets pour la scène. Depuis 2015, mes spectacles explorent donc le théâtre dans sa forme la plus simple, en s’étonnant du dispositif théâtral lui-même plutôt que de chercher à le décorer ou à l’encombrer.
L’aridité de ce que vous proposez sur scène est pourtant contrebalancée par une vraie générosité : vous proposez de vivre, ensemble, avec peu de choses, le petit miracle du théâtre dans sa forme la plus nue.
Il y a la générosité, mais il y a la douceur aussi. En assistant au filage de mon tout premier spectacle, Pièces courtes 1-9 en 2015, j’ai réalisé que je faisais un théâtre très doux : pas d’emphase ou de puissance théâtrale affirmée, un rapport à l’hybris très modéré, des actions souvent modestes et peu efficaces sur le plan spectaculaire. Puis j’ai compris que cette « douceur » pouvait provoquer des réactions outrées. Lors d’une des premières représentations, entre deux de ces courtes pièces – des « tâches » performées en silence –, une spectatrice est montée sur scène et a interrompu le spectacle pendant presque vingt minutes en insultant tout le monde : les acteurs, le public, l’institution, la représentation. Et ça a été pour moi une satisfaction d’entrevoir que cette douceur pouvait devenir une machine enragée. Depuis que mes spectacles sont plus « affirmatifs », ils sont aussi plus généreux dans leur rhétorique et leur adresse : il est important que le public puisse aimer les interprètes qui sont sur scène. Si on les aime, on veut les comprendre.
Malgré cela, votre travail est souvent perçu comme un « théâtre de recherche » ou « de spécialistes ». Et ce sont précisément ces franges-là de la création qui sont les plus visées lorsque le soutien à la création est menacé. Comment résister à cette soumission ?
Quand j’ai commencé à travailler dans le théâtre, je l’ai fait avec le sentiment d’arriver au carrefour de plusieurs fins : fin de la décentralisation culturelle, fin du théâtre post-dramatique, fin de certaines œuvres (Pina Bausch, Claude Régy). Et c’est ce vertige de fin de séquence qui a engendré ces travaux sur l’histoire du théâtre. J’ajoute à ce vertige une idée désormais dévaluée du théâtre, dans un contexte où les services publics sont annoncés comme obsolètes, outranciers, iniques, inutiles et qu’ordre est donné de les privatiser.
Le vrai problème ça n’est donc pas celui de la chapelle « théâtre de recherche » – qui depuis que je la fréquente a toujours pris des coups –, mais le processus de prolétarisation imposé sans état d’âme aux travailleur·euses du théâtre de service public dans son ensemble. Pour l’instant, je ne vois que trois solutions : la première, aller directement vendre ses spectacles à Hermès ou Van Cleef & Arpels – mais sur ce point j’ai fait vœu de pauvreté. La deuxième, faire sécession, et par sécession j’entends : ne plus produire d’art et aller plutôt faire de l’agriculture, ce que je n’exclue pas. La dernière : affirmer qu’on meurt de solitude et essayer de trouver encore un endroit pour ne pas être seuls.
Tout votre travail porte sur l’évolution de la fonction du théâtre dans nos sociétés à travers les âges. Fort de cette connaissance, qu’observez-vous de notre rapport contemporain aux arts de la scène ?
D’un point de vue « culturel », le théâtre est devenu un fétiche pour une élite culturelle largement déculturée. Et c’est cette même élite qui émet, avec beaucoup de misologie, des accusations ahurissantes d’élitisme pour ne pas avoir à justifier leur façon de penser par le bas la question du « public » – ou des « territoires » ou de « la vie des gens ».
Mais le théâtre que l’on connaît aujourd’hui peut changer : chaque époque trouve un chemin pour y inventer son art – et dans le même battement, sa révolte. Face à une époque qui annonce et performe la catastrophe, il n’y a pas de raison que le théâtre – qui devient par conséquence un théâtre de l’effondrement – n’ait à embrasser les nouvelles peurs, les nouvelles croyances, les nouveaux espoirs que cet effondrement nous amène. C’est pourquoi je m’intéresse, avec Okina par exemple, à ces formes de théâtres vernaculaires et utilitaires, renvoyant le plus souvent ses interprètes à divers cercles de superstitions, de croyances agricoles ou de négociations avec la nature.
Votre spectacle actuel, Okina, est la réactivation d’une pièce japonaise du XVe siècle qui revêtait en son temps une dimension sacrée. Quel sens un rituel si ancien peut-il prendre quand on le joue aujourd’hui, en France ?
Cette pièce conserve une place à part au Japon et embrasse toujours ses fonction rituelles et purificatrices. Elle a par exemple été jouée pendant la pandémie de Covid ou encore en 2021 pour la commémoration décennale de l’accident nucléaire de Fukushima. Sa forme aussi la distingue : elle n’a pas de script narratif mais présente une suite de danses. On la surnomme d’ailleurs « la pièce de nô qui n’en est pas une ». Ses gestes s’inspirent de rites agraires où l’on foulait le sol pour faire remonter les semences enfouies sous le gel hivernal : il en allait de la prospérité des récoltes à venir. Et par la façon dont ces acteurs du XVe siècle ont syncrétisé des rites très anciens avec des enjeux d’ordre esthétiques, c’est aussi la pièce qui formalise une naissance du théâtre comme art. Mais si les gestes d’Okina ont encore une fonction curative au Japon, ce rapport au théâtre n’est en Europe plus vraiment possible. Pourtant, en la convoquant, j’en appelle à notre capacité à raviver ce type de croyance théâtrale. Ça n’est pas forcément quelque chose de mystique, mais plutôt un chemin possible pour l’art de s’opposer à l’idée même de catastrophe.
Entretien de Maxime Kurvers par Thomas Corlin pour Mouvement, janvier 2025
⇢ Okina de Maxime Kurvers, les 24 et 24 janvier dans le cadre du festival Bruit au Théâtre de l’Aquarium, Paris ; les 31 janvier et 1er février dans le cadre du festival Ici & Là au Théâtre Garonne, Toulouse ; les 20 et 21 mars dans le cadre du festival Conversations au CNDC-Angers
⇢ 4 questions à Yoshi Oida de Maxime Kurvers, les 4 et 5 mars au TU-Nantes ; le 23 mars aux Bouffes du Nord, Paris ; les 2 et 3 avril à la Maison de la culture d’Amiens